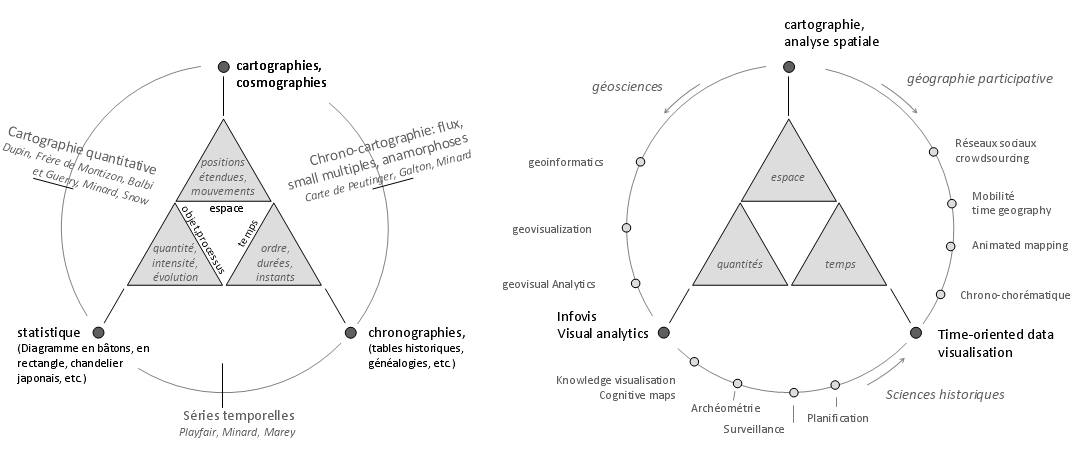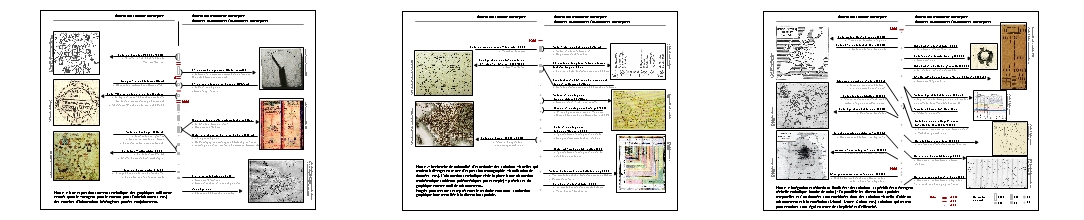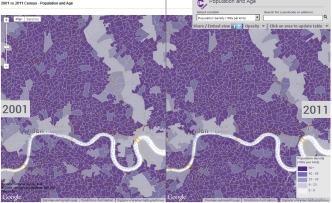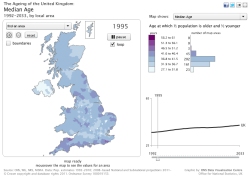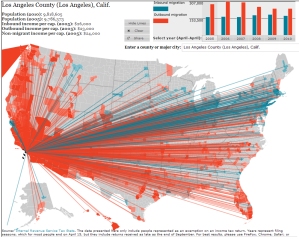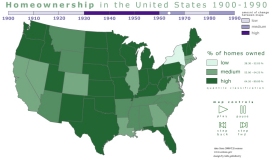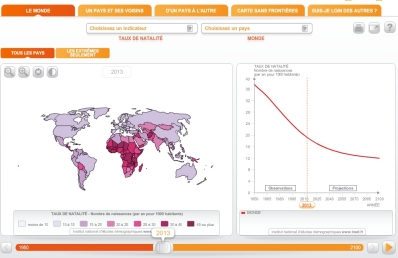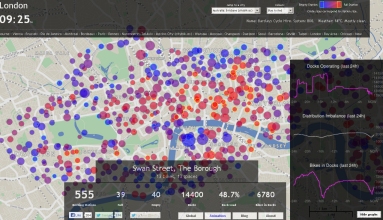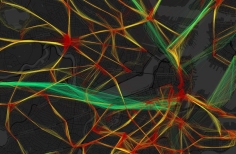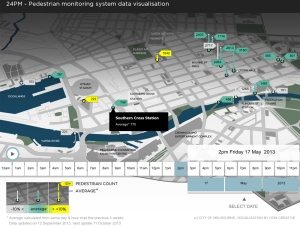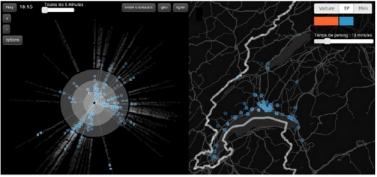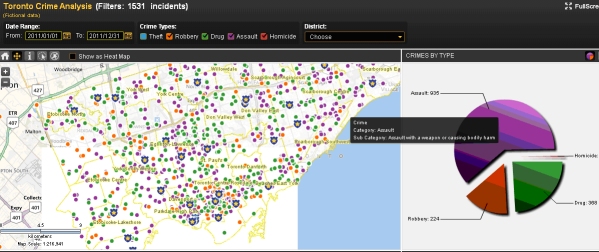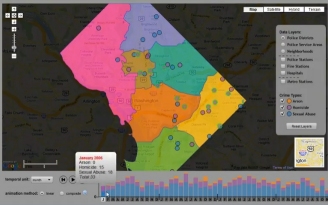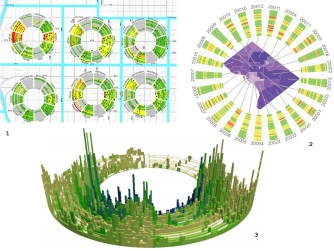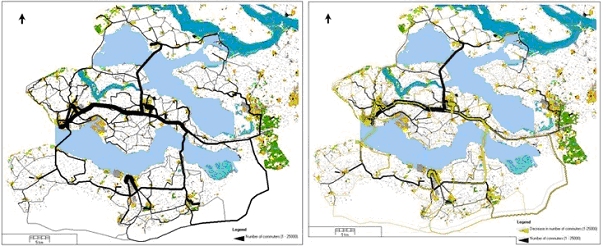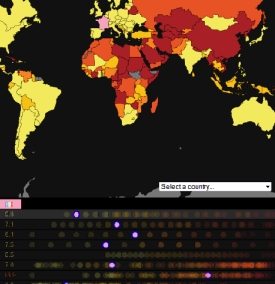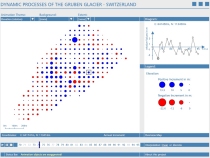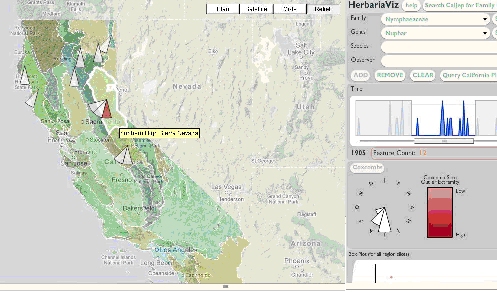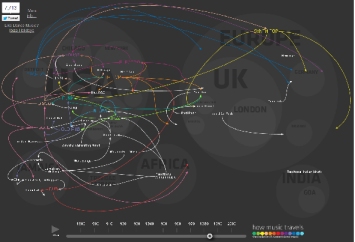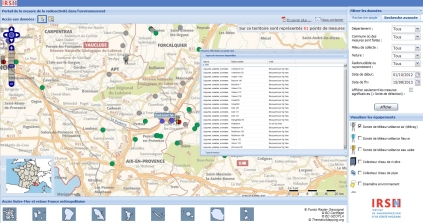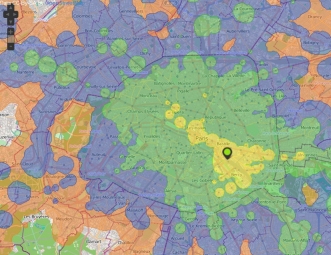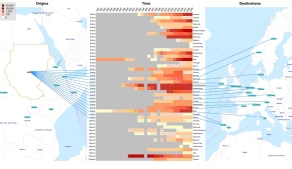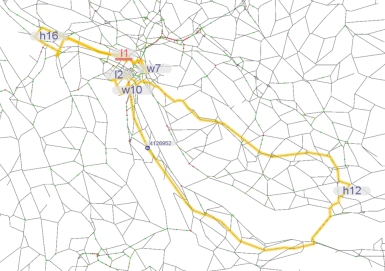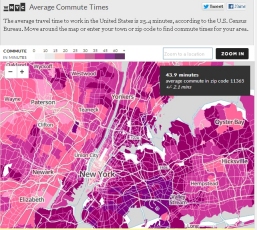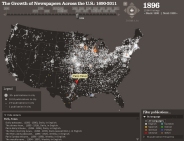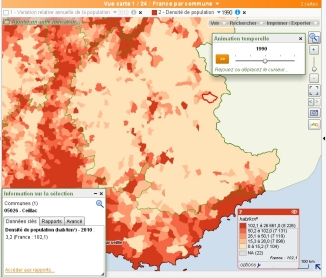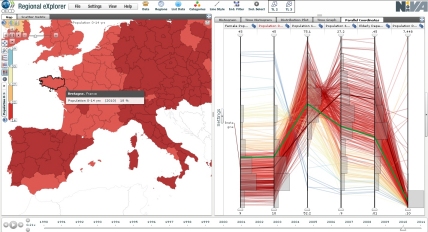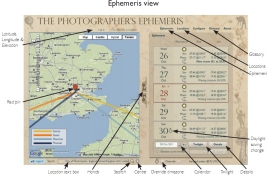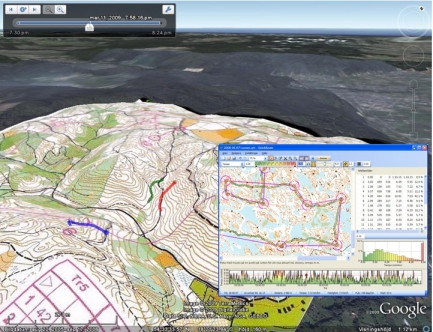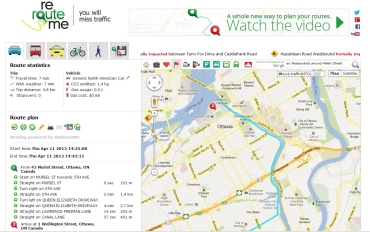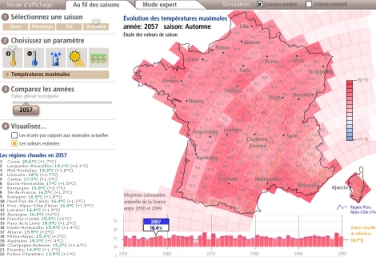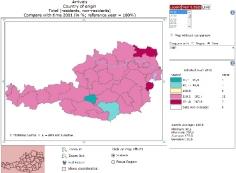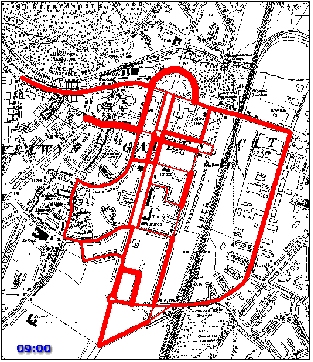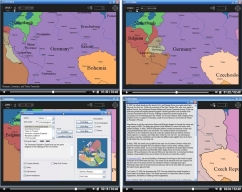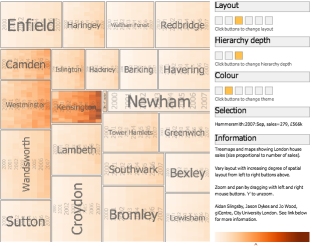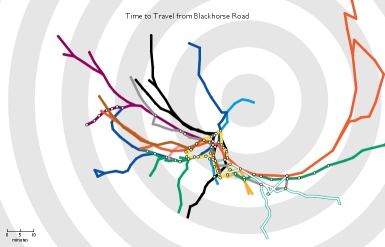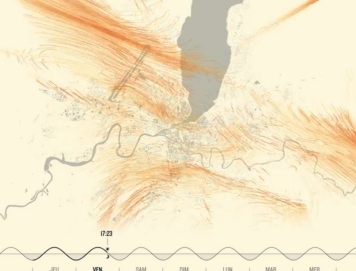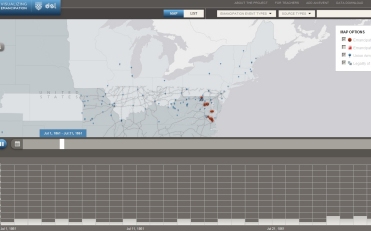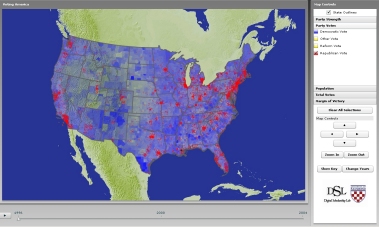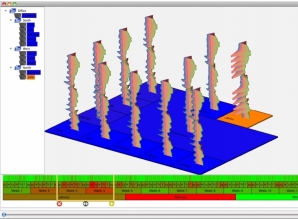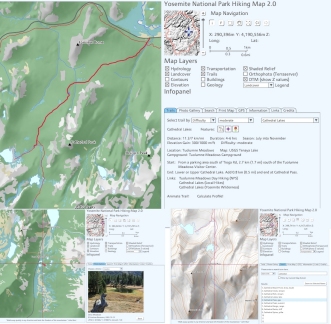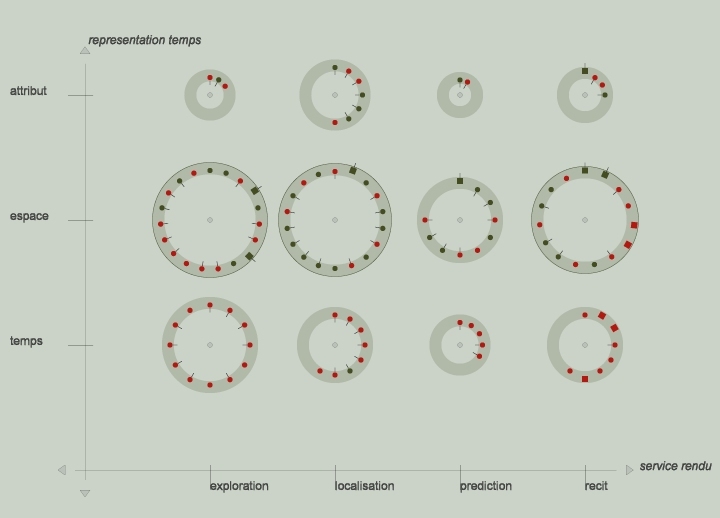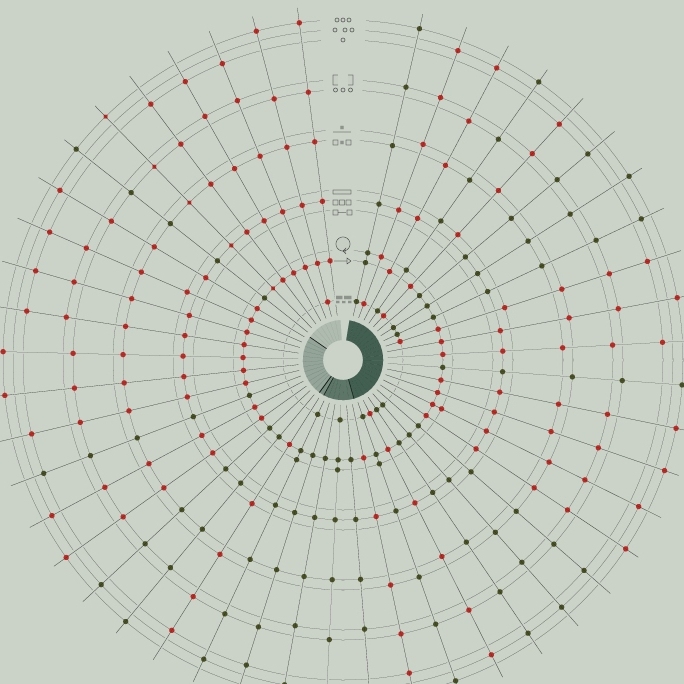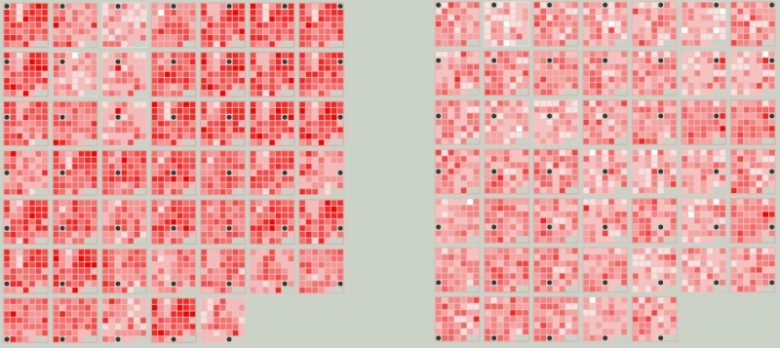Représentation dynamique
des temporalités des territoires
des temporalités des territoires

Représenter les dynamiques des territoires : un état des lieux, de nouveaux enjeux
Le temps et ses caractéristiques ont toujours fait l’objet de grandes attentions pour comprendre les dynamiques des territoires. Aujourd’hui, que ce soit à cause des nouvelles capacités d’observation en temps réel, de l’accumulation des séries de données au cours du temps, ou à cause de la multiplication des rythmes, les temporalités à prendre en compte pour comprendre les dynamiques territoriales se multiplient et leurs imbrications se complexifient. Interroger les rythmes, les vitesses, les cycles de ces dynamiques, ou mettre en relation temporelle des phénomènes spatiaux tels que les évènements catastrophiques passés devient plus que jamais un enjeu pour comprendre et décider.
Les jeux de méthodes mobilisables aujourd’hui pour représenter les temporalités des territoires sont en plein renouvellement, et imposent désormais bien souvent de franchir les fractures disciplinaires traditionnelles entre échelles, entre outils, entre formalismes. Les domaines d’applications potentiellement concernés, comme celui du développement durable des territoires, sont autant de domaines susceptibles de nourrir les questions associées à l’exploration des temporalités des territoires.
un sujet, des héritages, une intersection ▼
Le projet "Représentation dynamique des temporalités des territoires" se veut un état des lieux de différents développements et solutions pour analyser et rendre compte des temporalités des territoires. Cet état des lieux est à entrées multiples, interrogeant à la fois des choix amont (modélisation) et des choix proprement liés à la question de la représentation. Le projet débouche sur un ensemble de résultats dont certains sont mis en ligne dans ce site:
- Une grille de lecture de la collection d'applications analysée (voir onglet "47 applications"), grille où sont combinés des indicateurs généraux sur par exmeple le type de service rendu ou le type de dynamique spatiale analysée, et des indicateurs plus spécifiques au traitetment des dimensions spatiales et temporelles. Cette grille est mise en place sur 47 applications identifiées et analysées,
- Des visualisations récapitulatives conçues comme outils d'analyse comparative de la collection (voir onglet "visualisations"),
- Une bibliographie structurée en relation avec la grille de lecture (voir onglet "bibliographie").
- Programme et présentations du séminaire conclusif organisé en février 2014 (voir ci-dessous).
- Le rapport final du projet (versions avec/sans annexes, voir ci-dessous).
Les 47 applications analysées au cours du projet sont listées ci-dessous avec pour chacune d'entre elles un lien vers
une fiche A4 résumée (format PDF) décrivant les principales caractéristiques de l'application,
et un lien vers le site en ligne de l'application elle-même. Une vignette est affichable à la demande.
Deux présentations récapitulatives, par blocs et en tableaux, sont proposées en fin de page
2001 vs 2011 Census - Population and Age
Office for National Statistics (ONS) UK
http://www.ons.gov.uk/ons/interactive/census-map-1-4/index.html
 ?▼
?▼
Ageing and the UK
Office for National Statistics (ONS) UK
http://www.ons.gov.uk/ons/interactive/theme-pages-1-2/age-interactive-map.html
 ?▼
?▼
American migration
J.Bruner
http://www.forbes.com/special-report/2011/migration.html
 ?▼
?▼
Animeye
S.Fabrikant, D.R Montello (UCSB)
http://www.geog.ucsb.edu/~animeye/animations.htm
 ?▼
?▼
Atlas INED
INED
http://www.ined.fr/fr/tout_savoir_population/cartes_interactives/
 ?▼
?▼
Bike Share Map
O. O'Brien CASA UCL
http://bikes.oobrien.com/london/
 ?▼
?▼
Bostonography
A. Woodruff
http://www.theatlanticcities.com/commute/2013/06/beauty-buses-motion/5808/
 ?▼
?▼
City of Melbourne pedestrian monitoring system
City of Melbourne
http://www.pedestrian.melbourne.vic.gov.au
 ?▼
?▼
Commuting Scales
B. Beaude, L.Guillemot
http://choros.ch
 ?▼
?▼
Crime Analysis
DBx GEOMATICS
http://www.cartovista.com/CartoVista/CrimeAnalysis.aspx?Language=fr
 ?▼
?▼
CrimeViz
GeoVista Pennsylvania State University
http://www.geovista.psu.edu/CrimeViz
 ?▼
?▼
Data rose – Ring maps
K.Bell ; G.Huang et al. ; J. Zhao, P. Forer,A.S. Harvey
http://www.directionsmag.com/articles/visualizing-crime-a-data-rose-blooms/204984
 ?▼
?▼
FlowMap
J. van Dijk (Utrecht University)
http://flowmap.geog.uu.nl/index.php
 ?▼
?▼
Global Peace Index
Vision of humanity
http://www.visionofhumanity.org/gpi-data/
 ?▼
?▼
Gruben Glacier
Y.Isakowski
http://www.carto.net/svg/gruben_glacier/index.svgz
 ?▼
?▼
HerbariaViz
T.Auer, C. McCabe, PennState University
http://www.geovista.psu.edu/herbaria/v3/index.html
 ?▼
?▼
How music travels
Thomson
http://www.thomson.co.uk/blog/wp-content/uploads/infographic/interactive-music-map/index.html
 ?▼
?▼
InstantAtlas Dynamic Reports
InstantAtlas (GeoWise)
http://www.instantatlas.com/index.xhtml
 ?▼
?▼
IRSN Mesure de la radioactivité dans l’environnement
irsn
http://sws.irsn.fr/sws/mesure/index
 ?▼
?▼
Isokron
Isokron - Isokron
http://old.isokron.com/?language=fr
 ?▼
?▼
JflowMap
I. Boyandin
http://code.google.com/p/jflowmap/wiki/Flowstrates
 ?▼
?▼
Marine Traffic
MarineTraffic.com
http://marinetraffic.com/ais/fr/default.aspx
 ?▼
?▼
MATSim
MATSim
http://www.matsim.org/
 ?▼
?▼
Mega-Commuters Take Manhattan
Robert T.Gonzalez
http://www.wnyc.org/articles/wnyc-news/2013/mar/05/mega-commuters-take-manhattan
 ?▼
?▼
MIRO
A.Banos et al.
http://miro.csregistry.org/home
 ?▼
?▼
Newspaper accross the US
Stanford University
http://www.stanford.edu/group/ruralwest/cgi-bin/drupal/visualizations/us_newspapers
 ?▼
?▼
Observatoire des territoires
http://carto.observatoire-des-territoires.gouv.fr/
DATAR
 ?▼
?▼
OECD Regional eXplorer
NComVA
http://stats.oecd.org/OECDregionalstatistics
 ?▼
?▼
Photographers ephemeris
S. Trainor, J Crookneck Consulting LLC.
http://photoephemeris.com/
 ?▼
?▼
Quick route
M. Troeng, J. Ohlin
http://www.matstroeng.se/quickroute/fr/index.php
 ?▼
?▼
ReRouteMe
Rhexia Incorporated
http://www.rerouteme.com
 ?▼
?▼
Sars Epidemic
A.Banos, J.Lacasa.
http://arnaudbanos.perso.neuf.fr/SARS/sars_epidemic.html
 ?▼
?▼
Simulateur climatique Météo France
indid pour Meteo France et Sciences vie
http://climat.meteofrance.com/jsp/site/Portal.jsp?page_id=12979
 ?▼
?▼
Small arms and ammunitions
Google
http://workshop.chromeexperiments.com/projects/armsglobe/
 ?▼
?▼
Statistic Austria
STATISTIK AUSTRIA
http://www.statistik.at/OnlineAtlasWeb/start?action=start&atlas=1
 ?▼
?▼
STEM gis Animations
Discovery Software Ltd
http://www.discoverysoftware.co.uk/GalleryTraffic.htm
 ?▼
?▼
The centennia historical atlas
F.Reed (Centennia Software)
http://www.clockwk.com/
 ?▼
?▼
TimeMap
I. Johnson et al., University of Sydney.
http://ecai.org/tech/timemap.html
 ?▼
?▼
Treemaps House Prices
A. Slingsby, J. Dykes, J. Wood, A. Crooks.
http://www.gicentre.org/houseprices/demo/index.html
 ?▼
?▼
TubeMap London
Tom Carden
http://www.tom-carden.co.uk/p5/tube_map_travel_times/applet/
 ?▼
?▼
Vélib
E. Côme
http://www.comeetie.fr/galerie/velib/
 ?▼
?▼
Ville Vivante Genève
Ville de Genève, Lift and Near Future Laboratory, Interactive things
http://villevivante.ch/fr/
 ?▼
?▼
Visualizing emancipation
Digital Scholarship Lab, University of Richmond
http://dsl.richmond.edu/emancipation/
 ?▼
?▼
Voting America
Digital Scholarship Lab, University of Richmond
http://dsl.richmond.edu/voting/index.html
 ?▼
?▼
Wakame
C. Forlines, K. Wittenburg
http://www.merl.com/publications/docs/TR2010-031.pdf
 ?▼
?▼
Wind Map
Hint.fm
http://hint.fm/wind/
 ?▼
?▼
Yosemite National Park Hiking Map
J.Neumann, A.Neumann
http://www.carto.net/williams/yosemite/index.svg
 ?▼
?▼
Récapitulatif par blocs
Récapitulatif en tableau
Deux présentations récapitulatives, par blocs et en tableaux, sont proposées en fin de page
2001 vs 2011 Census - Population and Age
Office for National Statistics (ONS) UK
http://www.ons.gov.uk/ons/interactive/census-map-1-4/index.html
 ?▼
?▼
Ageing and the UK
Office for National Statistics (ONS) UK
http://www.ons.gov.uk/ons/interactive/theme-pages-1-2/age-interactive-map.html
 ?▼
?▼
American migration
J.Bruner
http://www.forbes.com/special-report/2011/migration.html
 ?▼
?▼
Animeye
S.Fabrikant, D.R Montello (UCSB)
http://www.geog.ucsb.edu/~animeye/animations.htm
 ?▼
?▼
Atlas INED
INED
http://www.ined.fr/fr/tout_savoir_population/cartes_interactives/
 ?▼
?▼
Bike Share Map
O. O'Brien CASA UCL
http://bikes.oobrien.com/london/
 ?▼
?▼
Bostonography
A. Woodruff
http://www.theatlanticcities.com/commute/2013/06/beauty-buses-motion/5808/
 ?▼
?▼
City of Melbourne pedestrian monitoring system
City of Melbourne
http://www.pedestrian.melbourne.vic.gov.au
 ?▼
?▼
Commuting Scales
B. Beaude, L.Guillemot
http://choros.ch
 ?▼
?▼
Crime Analysis
DBx GEOMATICS
http://www.cartovista.com/CartoVista/CrimeAnalysis.aspx?Language=fr
 ?▼
?▼
CrimeViz
GeoVista Pennsylvania State University
http://www.geovista.psu.edu/CrimeViz
 ?▼
?▼
Data rose – Ring maps
K.Bell ; G.Huang et al. ; J. Zhao, P. Forer,A.S. Harvey
http://www.directionsmag.com/articles/visualizing-crime-a-data-rose-blooms/204984
 ?▼
?▼
FlowMap
J. van Dijk (Utrecht University)
http://flowmap.geog.uu.nl/index.php
 ?▼
?▼
Global Peace Index
Vision of humanity
http://www.visionofhumanity.org/gpi-data/
 ?▼
?▼
Gruben Glacier
Y.Isakowski
http://www.carto.net/svg/gruben_glacier/index.svgz
 ?▼
?▼
HerbariaViz
T.Auer, C. McCabe, PennState University
http://www.geovista.psu.edu/herbaria/v3/index.html
 ?▼
?▼
How music travels
Thomson
http://www.thomson.co.uk/blog/wp-content/uploads/infographic/interactive-music-map/index.html
 ?▼
?▼
InstantAtlas Dynamic Reports
InstantAtlas (GeoWise)
http://www.instantatlas.com/index.xhtml
 ?▼
?▼
IRSN Mesure de la radioactivité dans l’environnement
irsn
http://sws.irsn.fr/sws/mesure/index
 ?▼
?▼
Isokron
Isokron - Isokron
http://old.isokron.com/?language=fr
 ?▼
?▼
JflowMap
I. Boyandin
http://code.google.com/p/jflowmap/wiki/Flowstrates
 ?▼
?▼
Marine Traffic
MarineTraffic.com
http://marinetraffic.com/ais/fr/default.aspx
 ?▼
?▼
MATSim
MATSim
http://www.matsim.org/
 ?▼
?▼
Mega-Commuters Take Manhattan
Robert T.Gonzalez
http://www.wnyc.org/articles/wnyc-news/2013/mar/05/mega-commuters-take-manhattan
 ?▼
?▼
MIRO
A.Banos et al.
http://miro.csregistry.org/home
 ?▼
?▼
Newspaper accross the US
Stanford University
http://www.stanford.edu/group/ruralwest/cgi-bin/drupal/visualizations/us_newspapers
 ?▼
?▼
Observatoire des territoires
http://carto.observatoire-des-territoires.gouv.fr/
DATAR
 ?▼
?▼
OECD Regional eXplorer
NComVA
http://stats.oecd.org/OECDregionalstatistics
 ?▼
?▼
Photographers ephemeris
S. Trainor, J Crookneck Consulting LLC.
http://photoephemeris.com/
 ?▼
?▼
Quick route
M. Troeng, J. Ohlin
http://www.matstroeng.se/quickroute/fr/index.php
 ?▼
?▼
ReRouteMe
Rhexia Incorporated
http://www.rerouteme.com
 ?▼
?▼
Sars Epidemic
A.Banos, J.Lacasa.
http://arnaudbanos.perso.neuf.fr/SARS/sars_epidemic.html
 ?▼
?▼
Simulateur climatique Météo France
indid pour Meteo France et Sciences vie
http://climat.meteofrance.com/jsp/site/Portal.jsp?page_id=12979
 ?▼
?▼
Small arms and ammunitions
http://workshop.chromeexperiments.com/projects/armsglobe/
 ?▼
?▼
Statistic Austria
STATISTIK AUSTRIA
http://www.statistik.at/OnlineAtlasWeb/start?action=start&atlas=1
 ?▼
?▼
STEM gis Animations
Discovery Software Ltd
http://www.discoverysoftware.co.uk/GalleryTraffic.htm
 ?▼
?▼
The centennia historical atlas
F.Reed (Centennia Software)
http://www.clockwk.com/
 ?▼
?▼
TimeMap
I. Johnson et al., University of Sydney.
http://ecai.org/tech/timemap.html
 ?▼
?▼
Treemaps House Prices
A. Slingsby, J. Dykes, J. Wood, A. Crooks.
http://www.gicentre.org/houseprices/demo/index.html
 ?▼
?▼
TubeMap London
Tom Carden
http://www.tom-carden.co.uk/p5/tube_map_travel_times/applet/
 ?▼
?▼
Vélib
E. Côme
http://www.comeetie.fr/galerie/velib/
 ?▼
?▼
Ville Vivante Genève
Ville de Genève, Lift and Near Future Laboratory, Interactive things
http://villevivante.ch/fr/
 ?▼
?▼
Visualizing emancipation
Digital Scholarship Lab, University of Richmond
http://dsl.richmond.edu/emancipation/
 ?▼
?▼
Voting America
Digital Scholarship Lab, University of Richmond
http://dsl.richmond.edu/voting/index.html
 ?▼
?▼
Wakame
C. Forlines, K. Wittenburg
http://www.merl.com/publications/docs/TR2010-031.pdf
 ?▼
?▼
Wind Map
Hint.fm
http://hint.fm/wind/
 ?▼
?▼
Yosemite National Park Hiking Map
J.Neumann, A.Neumann
http://www.carto.net/williams/yosemite/index.svg
 ?▼
?▼
Récapitulatif par blocs

Récapitulatif en tableau

Trois outils d’analyse comparative visuelle du recueil d'applications ont été développées
qui exploitent les grilles descriptives introduites dans le projet.
Ces visualisations ont pour objectif de rendre
compte de façon synthétique de la collection d'applications, et de ce qu'elle dit des pratiques actuelles
en matière de représentation des temporalités des territoires.
Visualisations interactives SVG, s'ouvrent dans une fenêtre nouvelle en sélectionnant les flèches orange
> Distribution bi-critères interactive
Cette visualisation a pour objectif de repérer au sein de la collection de cas des motifs dominants dans la façon dont se distribuent des couples de valeurs associant deux critères de description, comme par exemple « service rendu : prédiction ; représentation du temps : par des attributs ».
ouvrir la visualisation
plus de détails ▼
> Distribution multi-critères interactive
La collection d'applications est ici spécifiquement examinée du point de vue de la prise en compte du paramètre temps. Chacun des 47 cas est représenté sous la forme d’une radiale, le long de laquelle sont identifiées les caractéristiques spécifiques de l’application (un petit cercle marque une valeur « vraie »).
ouvrir la visualisation
plus de détails ▼
> Cartes et grilles de cohérence
Nous cherchons ici à mettre en évidence visuellement le degré de variabilité au sein de la collection, autrement dit à évaluer dans quelle mesure les choix faits par les concepteurs des 47 applications (en terme de modélisation comme en terme de représentation) sont les mêmes.
Pour chaque application nous mesurons un index de similarité basique, correspondant au nombre de valeurs communes avec les 47 autres applications. L’index de similarité est traduit par une échelle chromatique : plus sa colorisation est intense, plus une application « ressemble » aux autres. Les valeurs elles-mêmes sont affichées à la requête de l'utilisateur, et l’échelle globale présentée à côté du graphique.
ouvrir la visualisation
plus de détails ▼
Visualisations interactives SVG, s'ouvrent dans une fenêtre nouvelle en sélectionnant les flèches orange
> Distribution bi-critères interactive
Cette visualisation a pour objectif de repérer au sein de la collection de cas des motifs dominants dans la façon dont se distribuent des couples de valeurs associant deux critères de description, comme par exemple « service rendu : prédiction ; représentation du temps : par des attributs ».
ouvrir la visualisation

plus de détails ▼
> Distribution multi-critères interactive
La collection d'applications est ici spécifiquement examinée du point de vue de la prise en compte du paramètre temps. Chacun des 47 cas est représenté sous la forme d’une radiale, le long de laquelle sont identifiées les caractéristiques spécifiques de l’application (un petit cercle marque une valeur « vraie »).
ouvrir la visualisation

plus de détails ▼
> Cartes et grilles de cohérence
Nous cherchons ici à mettre en évidence visuellement le degré de variabilité au sein de la collection, autrement dit à évaluer dans quelle mesure les choix faits par les concepteurs des 47 applications (en terme de modélisation comme en terme de représentation) sont les mêmes.
Pour chaque application nous mesurons un index de similarité basique, correspondant au nombre de valeurs communes avec les 47 autres applications. L’index de similarité est traduit par une échelle chromatique : plus sa colorisation est intense, plus une application « ressemble » aux autres. Les valeurs elles-mêmes sont affichées à la requête de l'utilisateur, et l’échelle globale présentée à côté du graphique.
ouvrir la visualisation

plus de détails ▼
La bibliographie rassemblée durant le projet est ici structurée, triée, en fonction d'une série de critères
associés à la grille de lecture mise au point dans le cadre du projet. Ne sont mentionnées dans cette
bibliographie que des ressources accessibles sur la toile. Pour chaque sous-catégorie une série de démos en ligne
complète des publications scientifiques plus classiques.
les catégories et sous-catégories sont identifiées ci-dessous, les références elles-mêmes sont présentées sous la forme de fichiers PDF autonomes accessibles derrière les flèches orange.
A.Tri par la portée temporelle
Temps immédiat
Analyses portant sur quelques heures ou quelques jours, granularités de la seconde à la journée, échelle ou portée habituelle inférieure à 2 semaines.
ouvrir la liste de références
Temps court
Analyses portant sur quelques semaines ou quelques mois, granularités de la journée au mois, échelle ou portée habituelle inférieure à 1 an.
ouvrir la liste de références
Temps intermédiaire
Analyses portant sur quelques années ou quelques dizaines d’années, granularités de la semaine à l’année, échelle ou portée habituelle inférieure au siècle.
ouvrir la liste de références
Temps de l’Histoire (temps long)
Analyses portant souvent sur un ou plusieurs siècles, granularités l’année au siècle, échelle ou portée habituelle supérieure au siècle. Mais ce temps se caractérise d’abord notamment par une granularité des données fortement hétérogène (indications à la journée ou à l’heure coexistant avec des indications à l’année par exemple), une répartition des données dans le temps très inégale (densités d’indications variant selon la période observée), et des problèmes de crédibilité et de vérifiabilité fondamentaux.
ouvrir la liste de références
B.Tri par la granularité spatiale
Etats > cantons
Analyses portant sur les évolutions et/ou sur les échanges entre entités politiques largement autonomes, le plus souvent de grande dimension, formant ou non un territoire continu (> cas typique : flux migratoire d’Etat à Etat). Analyses portant sur les évolutions et/ou sur les échanges entre entités politiques ou administratives formant réseau au sein d’entités constituant des ensembles cohérents plus larges, ensembles au sein desquels on cherche à isoler et comparer des motifs spatio-temporels divergents ou convergents (> cas typique : statistiques démographiques à l’intérieur d’un ou de plusieurs pays).
ouvrir la liste de références
Agglomérations > communes
Analyses portant sur les évolutions ou les temporalités de territoires composites, formés d’entités le plus souvent en continuité spatiale et/ou que l’on considère comme un ensemble cohérent. Niveau où le parcellaire ou la forme urbaine ne sont pas étudiés en tant que tels (> cas typique : réseaux de transports et mobilités).
ouvrir la liste de références
Entités géographiques spécifiques
Analyses portant sur les temporalités internes d’espaces considérés comme cohérents et continus au vu de contraintes naturelles (volcan, marais, glacier, lagune, …) ou de règles d’usage (parcs nationaux, réserves naturelles, ...). Ces espaces peuvent relever d’échelles variées mais sont caractérisés par un « système » spécifique à l’espace délimité, et donc par des temporalités spécifiques (> cas typique : suivi d’espèces animales dans les parcs nationaux).
ouvrir la liste de références
Ilots > parcelle
Analyses portant sur les évolutions, les échanges et les temporalités d’espaces urbains continus et en interrelation, nécessitant de prendre en compte la forme urbaine (> cas typique : simulations d’accessibilité en milieu urbain). Analyses portant sur les temporalités de lieux-noyaux, caractérisables par une adresse / une surface (> cas typique : évolution historique du parcellaire, extensions urbaines).
ouvrir la liste de références
Points / positions
Analyses portant sur les évolutions, les échanges et les temporalités d’espaces urbains continus et en interrelation, nécessitant de prendre en compte la forme urbaine (> cas typique : simulations d’accessibilité en milieu urbain). Analyses portant sur les temporalités de lieux-noyaux, caractérisables par une adresse / une surface (> cas typique : évolution historique du parcellaire, extensions urbaines).
ouvrir la liste de références
C.Tri par le type de dynamique spatiale
Localisation
Analyses ayant pour but de distribuer dans l’espace et dans le temps des évènements ou des entités fixes sur un territoire donné. (> cas typique : distribution des commerces sur une ville)
ouvrir la liste de références
Etats
Analyses portant sur des évolutions ayant lieu à l’intérieur d’un zonage spatial fixe : le territoire est un support sur lequel un processus est positionné, mais ce processus n’en modifie pas la forme. (> cas typique : statistiques démographiques)
ouvrir la liste de références
Transformations
Analyses portant sur les transformations subies par un espace donné, qui en modifient la forme. (> cas typique : évolution d’un glacier au cours du temps )
ouvrir la liste de références
Mouvements individuels
Analyses portant sur le suivi des mouvements individuels à l’intérieur d’un espace donné. (> cas typique : mobilités urbaines)
ouvrir la liste de références
Flux
Analyses de quantités en mouvement entre territoires, impliquant l’existence de vecteurs origine/ destination et celle de quantités échangées. (> cas typique : échanges commerciaux entre régions ou nations)
ouvrir la liste de références
les catégories et sous-catégories sont identifiées ci-dessous, les références elles-mêmes sont présentées sous la forme de fichiers PDF autonomes accessibles derrière les flèches orange.
A.Tri par la portée temporelle
Temps immédiat
Analyses portant sur quelques heures ou quelques jours, granularités de la seconde à la journée, échelle ou portée habituelle inférieure à 2 semaines.
ouvrir la liste de références

Temps court
Analyses portant sur quelques semaines ou quelques mois, granularités de la journée au mois, échelle ou portée habituelle inférieure à 1 an.
ouvrir la liste de références

Temps intermédiaire
Analyses portant sur quelques années ou quelques dizaines d’années, granularités de la semaine à l’année, échelle ou portée habituelle inférieure au siècle.
ouvrir la liste de références

Temps de l’Histoire (temps long)
Analyses portant souvent sur un ou plusieurs siècles, granularités l’année au siècle, échelle ou portée habituelle supérieure au siècle. Mais ce temps se caractérise d’abord notamment par une granularité des données fortement hétérogène (indications à la journée ou à l’heure coexistant avec des indications à l’année par exemple), une répartition des données dans le temps très inégale (densités d’indications variant selon la période observée), et des problèmes de crédibilité et de vérifiabilité fondamentaux.
ouvrir la liste de références

B.Tri par la granularité spatiale
Etats > cantons
Analyses portant sur les évolutions et/ou sur les échanges entre entités politiques largement autonomes, le plus souvent de grande dimension, formant ou non un territoire continu (> cas typique : flux migratoire d’Etat à Etat). Analyses portant sur les évolutions et/ou sur les échanges entre entités politiques ou administratives formant réseau au sein d’entités constituant des ensembles cohérents plus larges, ensembles au sein desquels on cherche à isoler et comparer des motifs spatio-temporels divergents ou convergents (> cas typique : statistiques démographiques à l’intérieur d’un ou de plusieurs pays).
ouvrir la liste de références

Agglomérations > communes
Analyses portant sur les évolutions ou les temporalités de territoires composites, formés d’entités le plus souvent en continuité spatiale et/ou que l’on considère comme un ensemble cohérent. Niveau où le parcellaire ou la forme urbaine ne sont pas étudiés en tant que tels (> cas typique : réseaux de transports et mobilités).
ouvrir la liste de références

Entités géographiques spécifiques
Analyses portant sur les temporalités internes d’espaces considérés comme cohérents et continus au vu de contraintes naturelles (volcan, marais, glacier, lagune, …) ou de règles d’usage (parcs nationaux, réserves naturelles, ...). Ces espaces peuvent relever d’échelles variées mais sont caractérisés par un « système » spécifique à l’espace délimité, et donc par des temporalités spécifiques (> cas typique : suivi d’espèces animales dans les parcs nationaux).
ouvrir la liste de références

Ilots > parcelle
Analyses portant sur les évolutions, les échanges et les temporalités d’espaces urbains continus et en interrelation, nécessitant de prendre en compte la forme urbaine (> cas typique : simulations d’accessibilité en milieu urbain). Analyses portant sur les temporalités de lieux-noyaux, caractérisables par une adresse / une surface (> cas typique : évolution historique du parcellaire, extensions urbaines).
ouvrir la liste de références

Points / positions
Analyses portant sur les évolutions, les échanges et les temporalités d’espaces urbains continus et en interrelation, nécessitant de prendre en compte la forme urbaine (> cas typique : simulations d’accessibilité en milieu urbain). Analyses portant sur les temporalités de lieux-noyaux, caractérisables par une adresse / une surface (> cas typique : évolution historique du parcellaire, extensions urbaines).
ouvrir la liste de références

C.Tri par le type de dynamique spatiale
Localisation
Analyses ayant pour but de distribuer dans l’espace et dans le temps des évènements ou des entités fixes sur un territoire donné. (> cas typique : distribution des commerces sur une ville)
ouvrir la liste de références

Etats
Analyses portant sur des évolutions ayant lieu à l’intérieur d’un zonage spatial fixe : le territoire est un support sur lequel un processus est positionné, mais ce processus n’en modifie pas la forme. (> cas typique : statistiques démographiques)
ouvrir la liste de références

Transformations
Analyses portant sur les transformations subies par un espace donné, qui en modifient la forme. (> cas typique : évolution d’un glacier au cours du temps )
ouvrir la liste de références

Mouvements individuels
Analyses portant sur le suivi des mouvements individuels à l’intérieur d’un espace donné. (> cas typique : mobilités urbaines)
ouvrir la liste de références

Flux
Analyses de quantités en mouvement entre territoires, impliquant l’existence de vecteurs origine/ destination et celle de quantités échangées. (> cas typique : échanges commerciaux entre régions ou nations)
ouvrir la liste de références

Projet commandité par le PUCA (Plan, Urbanisme, Construction, Architecture)

MEDDE ministère de l'Ecologie, du Développement durable et de l'Energie.
Contacts:
Lahouari KADDOURI, Université d’Avignon, UMR 7300 Espace
Jean-Yves BLAISE, CNRS, UMR CNRS/MCC 3495 MAP
Paule-Annick DAVOINE, Université de Grenoble-INP, LIG – STEAMER
Hélène MATHIAN, CNRS, UMR 8504 Géographie-Cités
Cécile SAINT-MARC, Université de Grenoble-INP, LIG – STEAMER

MEDDE ministère de l'Ecologie, du Développement durable et de l'Energie.
Contacts:
Lahouari KADDOURI, Université d’Avignon, UMR 7300 Espace
Jean-Yves BLAISE, CNRS, UMR CNRS/MCC 3495 MAP
Paule-Annick DAVOINE, Université de Grenoble-INP, LIG – STEAMER
Hélène MATHIAN, CNRS, UMR 8504 Géographie-Cités
Cécile SAINT-MARC, Université de Grenoble-INP, LIG – STEAMER