


project European (HORIZON-CL2-2024-HERITAGE-ECCCH-04) Innovation Actions
Pilier 2 "Recherche collaborative" - Cluster 2 - Culture, creativity & inclusive society
Coordonné par: E.Pietroni, CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche) Italie
Number of partners: 11
Durée du projet : 48 mois, (01/10/2025 - 30/09/2029)
Financement: Funding: Horizon Europe, Grant agreement ID: 101188018, call HORIZON-INFRA-2024-TECH-01-01 – R&D for the next generation of scientific instrumentation, tools, methods, solutions for RI upgrade
Ce projet de recherche vise à créer des applications numériques permettant aux utilisateurs d'explorer des lieux emblématiques de la musique dans différentes villes européennes. Ces applications proposent un récit entrelacé, intégrant l'événement musical lui-même, son contexte culturel et son lieu. Cette approche narrative à plusieurs niveaux s'appuiera sur des sources diverses, notamment des partitions musicales, des chroniques, des journaux intimes, des lettres, des traités philosophiques et des images.
Le projet consiste à cartographier géographiquement les lieux musicaux et à créer des itinéraires thématiques captivants, basés sur des lieux, des personnages, des thèmes et des périodes historiques, englobant un riche patrimoine matériel et immatériel. Il sera mis en œuvre à travers des études de cas, adaptables et extensibles à l'avenir. Il se concentrera sur le développement d'outils numériques de pointe pour enrichir l'expérience des visiteurs de ces lieux musicaux grâce à des expériences de réalité virtuelle et augmentée, et à des contenus multimédias accessibles via différentes applications et outils intégrés à l'ECCCH. L'accent sera mis notamment sur la reconstitution de paysages sonores historiques, ainsi que sur les propriétés acoustiques des espaces de représentation musicale, l'exploration des interactions entre musique et architecture, et l'exploitation du potentiel des technologies de réalité virtuelle et augmentée.
Le projet permettra également de créer des outils de conception et de simulation, ainsi que d'analyser et d'évaluer l'impact de la communication audiovisuelle dans les musées. Pour atteindre ces objectifs, il s'adressera à un public diversifié, comprenant des chercheurs, des conservateurs de musées, l'ensemble du secteur éducatif, les industries culturelles créatives, les citoyens et les touristes. L'ensemble des données, métadonnées et outils d'interaction seront open source et mis en œuvre conformément aux principes FAIR, conformément à la base de connaissances et aux exigences de l'ECCCH.




Coordonné par: OPEN ACCESS IN THE EUROPEAN AREA THROUGH SCHOLARLY COMMUNICATION, Belgium
Nombre de partenaires : 21
Financement: Funding: Horizon Europe, Grant agreement ID: 101188018, call HORIZON-INFRA-2024-TECH-01-01 – R&D for the next generation of scientific instrumentation, tools, methods, solutions for RI upgrade
Les sciences sociales et humaines (SSH) sont essentielles pour éclairer les décisions culturelles, économiques et éthiques, mais s’avèrent souvent déconnectées et inaccessibles, ce qui limite leur incidence sur la recherche et la société. Le projet GRAPHIA, financé par l’UE, entend créer un graphe de connaissances (GC) complet sur les SSH qui regroupe les données fragmentées en un point d’accès unique, améliorant ainsi la visualisation et l’analyse des données relatives aux SSH. Le projet adoptera une approche de GC innovante, utilisant l’IA pour enrichir, accéder et analyser les connaissances en SSH, notamment en développant le LLM4SSH (un grand modèle de langage pour les SSH). Cette initiative aidera les chercheurs à tirer des enseignements de données non structurées et à mieux appréhender les phénomènes sociaux et les tendances culturelles. L’index de citations en SSH de GRAPHIA simplifiera l’extraction et l’enrichissement des données de citations dans diverses disciplines de SSH.
Objectif
Social Sciences and Humanities (SSH) provide essential knowledge to society, informing our shared cultural, economical and ethical decisions. However, SSH knowledge remains largely disconnected and poorly available, impeding its full potential in research and societal applications. The GRAPHIA project aims to build the first comprehensive SSH Knowledge Graph (KG) that integrates currently disconnected data into a single entry point, leveraging existing infrastructure and data resources. GRAPHIA aspires to significantly improve SSH data visualisation and analysis capacities, pioneer advanced AI solutions tailored for SSH and develop re-usable, cutting-edge digital tools. GRAPHIA addresses the unique opportunities posed by the qualitative, diverse and context-rich data typical of SSH research where existing solutions fall short. GRAPHIA's innovative approach, centered around the KG, provides an expansive representation of SSH knowledge, while leveraging AI for its enrichment, access and deeper analysis, including an LLM4SSH. GRAPHIA aims to empower researchers to uncover patterns and insights from unstructured data, illuminating social phenomena and cultural trends with unprecedented clarity. A key component of GRAPHIA is the SSH Citation Index, an innovative framework for citation data extraction and enrichment across all SSH disciplines that dramatically speeds up access and understanding of previous literature on any topic. GRAPHIA transcends traditional research approaches by integrating industry partners into a cohesive partnership, which is pivotal to amplify the project's impact, drive forward innovations that are not only academically significant but also commercially viable, provide access to new markets and technologies and foster an environment of co-innovation. GRAPHIA is committed to open science and increasing EU Research Infrastructures capabilities, enhancing global competitiveness, while facilitating broad and long-lasting impact of project results.
Project page on Cordis: https://cordis.europa.eu/project/id/101188018
Website: https://graphia-ssh.eu/


L’objectif scientifique général de cette collaboration, est de faire de l’objet patrimonial majeur dont l’association Citadelle de Marseille a la charge un point de précipitation d’approches scientifiques pluridisciplinaires (sciences expérimentales et historiques) pouvant nourrir des parcours créatifs et/ou de médiation. Il s’agit d’ainsi questionner la fabrication de la donnée, sa documentation, son analyse et son exploitation dans la production de connaissances nouvelles (théoriques et procédurales) mais aussi dans l’appui qu’elle peut apporter à l’action de remédiation culturelle qu’appelle cet objet.



En collaboration avec (axe psychosocial) - Aurélie Pasquier (MCF, ADEF-GCAF), Mathilde M.P. Celume (ATER, Psyclé, AMU) et Virginie Depretto-Boffa (professeure des écoles, directrice de l’école maternelle Villette Fonscolombe)
cadre institutionnel: SFERE Provence (FED 4238, Aix Marseille Université)
L’objectif du projet est d’évaluer l’incidence de l’environnement éducatif, socio-émotionnel, culturel et physique (espaces visuels, sonores et aménagement des espaces) sur le bien-être des élèves et des enseignants.
Objectifs de l’axe architectural:
La stratégie choisie consiste à se doter des moyens de reproduire en laboratoire les conditions d'usage des classes à des fins de simulation et d'analyse perceptive. Le programme de travail couple d'une part la mise en place d'un protocole de relevé combinant relevé architectural et acoustique (protocole original appuyé sur les récentes expériences conjointes des laboratoires MAP et PRISM) et d'autre part exploitation des données collectées sous la forme de simulations (VR et son 3D) permettant de monter des tests perceptifs. On attend ainsi l'émergence d'une méthode (reproductible) permettant un 'diagnostic' rationnel de l'impact des perturbateurs visuels et sonores de l'attention et du confort des élèves comme des enseignants.


Responsable de projet : Livio De Luca
Equipe de recherche associée CNRS-MAP Gamsau : Jean-Yves Blaise, Iwona Dudek, Pascal Bénistant
La recherche sur le patrimoine culturel transforme la confrontation entre les objets matériels et les études pluridisciplinaires en un lieu de production de connaissances collectives. A l'ère du numérique, c'est alors un cadre privilégié pour étudier l'analyse et l'interprétation collectives de faits, d'objets et de phénomènes qui rassemblent une nouvelle génération de données vers la construction de nouvelles ressources scientifiques et culturelles - notre patrimoine de demain. Comment mémoriser ces faisceaux de regards individuels convergeant vers un même objet d'étude ? Comment analyser leurs dynamiques de construction, de superposition et de fusion pour aboutir à de nouvelles connaissances ?
Le projet bénéficie du cadre expérimental exceptionnel du chantier scientifique de Notre-Dame de Paris (impliquant aujourd'hui 175 chercheurs issus de disciplines telles que l'archéologie, l'anthropologie, l'architecture, l'histoire, la chimie, la physique et l'informatique) pour construire un corpus emblématique de données sur les pratiques scientifiques dans le domaine du patrimoine, à l'ère du numérique.
Dans le cadre de cette opportunité unique de produire et d'analyser des masses de données scientifiques numériques, n-Dame_Heritage fournira une approche généralisable, une méthodologie reproductible et un écosystème numérique ouvert et réutilisable pour construire des cathédrales de connaissances par la recherche collaborative sur des objets matériels. En introduisant et en expérimentant des méthodes et des outils de nouvelle génération pour la production et l'analyse de données sémantiques, ce projet déplace le curseur de la numérisation, de l'objet physique à la connaissance pour le comprendre, afin d'analyser l'interdépendance entre ses caractéristiques complexes et les objets de connaissance connexes construits par les chercheurs à travers leurs pratiques de recherche.





AAPG ANR 2018 CES 38 « La Révolution numérique : rapports aux savoirs et à la culture »
L’étude de l’artefact patrimonial est interrogée par un renouvellement de notre capacité à produire des masses d’observations, à croiser des jeux de données conséquents. Dans les sciences patrimoniales, où se substitue à une ambition d’explicitation de règles générales celle d’analyse objectivée d’histoires particulières, comment traduire ce plus en gain de sens ?
En réponse, Le projet vise à exemplifier et mettre en partage des démarches de caractérisation sémantique de faits, et de formaliser, de mémoriser à fins de reproductibilité, le raisonnement sur ces faits, et notamment les inférences du passage fait archéologique observé > fait architectural restitué.
Il est construit sur un jeu entre définition en intension/en extension de corpus, observés dans leurs dimensions sonores, spatiales et ontologiques, exploité pour la caractérisation d’individus et l’analyse comparative, phase pour laquelle est introduite une démarche exploratoire de sonification de données multidimensionnelles.



Le projet « Territographie » part de l’hypothèse générale que la démarche de science ouverte, et notamment les pratiques de science participative peuvent contribuer à lever une partie des verrous existants (verrous quantitatifs, cloisonnements disciplinaire, enjeux spécifiques au traitement de données massives) en matière d’observation et d’analyse du patrimoine dit mineur, et à faire émerger de nouvelles synergies entre la communauté scientifique, les acteurs culturels et le monde associatif.
Territographie est un projet exploratoire se caractérisant d’abord par la volonté non pas d’étudier UN patrimoine, mais DES territoires où se manifestent, s’inventent, se développent DES patrimoines qui en font les identités et les mémoires particulières. Centré dans cette phase exploratoire sur les bassins de la Durance, de l’Ubaye et de la Bléone, le projet souhaite mettre en relation trois collections hétérogènes, multi-échelle : collection « techniques agricoles » et « élevage » du MUCEM, chapelles isolées ou de hameau, et lieux d’échanges commerciaux en Haute-Provence. L’objectif du projet est de construire une plateforme type « science participative » autour de ces collections, i.e. de se faire relais des initiatives existantes sur ces territoires (notamment celles issues du milieu associatif), et au besoin de faire appel aux internautes pour compléter, commenter, enrichir ces collections. In fine, le projet proposera au travers d’un portail spécifique des modalités d’interrogation et de croisement des collections pouvant mettre en évidence des co-occurrences (dans l’espace et le temps) reliant objets, lieux, pratiques, co-occurrences qui doivent dessiner une sorte de « territographie » des patrimoines mineurs.



Le projet MEMORIA est un projet à long terme, qui à l’origine visait … la construction d’un système d’informations exploratoire avec pour objectif la description, la structuration, l’archivage et analyse des ressources numériques produites dans notre laboratoire ....
Aujourd’hui l’objectif du projet est plus généralement, au-delà des seules ressources produites par notre laboratoire, d’associer aux résultats scientifiques, en particulier en sciences historiques et patrimoniales, des indicateurs permettant de mieux retracer la façon dont ces résultats sont obtenus. L’enjeu à relever est donc de contribuer à éliciter, structurer, pérenniser et étudier les processus de production de ces résultats, en développant méthodes et outils pour assurer la transmissibilité intersubjective de ces processus, permettre l’interprétabilité, la vérifiabilité et la reproductibilité des résultats, et favoriser une lecture comparative et cumulative.
Cette volonté se traduit par le développement d’un Système d’Information permettant à un individu d’identifier les ressources produites et la démarche ayant abouti à leur production. À terme, le projet vise à mémoriser au-delà d’un document «final» une démarche cognitive et méthodologique.
Un point central de la démarche adoptée pour développer MEMORIA est la volonté de mettre au point des interfaces visuelles permettant d’une part de faciliter l’accès aux ressources et d’autre part de rendre possible une analyse fine des informations réunies dans la base de données. Ces interfaces doivent par exemple donner accès aux résultats de requêtes sur des ressources triées par objet d’étude, projet, processus de production, etc. mais aussi montrer l’évolution des méthodes de travail ou des techniques utilisées au cours du temps, ou encore les types d’activités mobilisées pour produire une ressource.
À présent le système permet d’associer à une ressource produite (un extrant numérique ou non) une série de descripteurs (du type format, auteurs, date de production, objet d’étude, etc.) permettant de caractériser le contenant et le contenu d’un extrant donné. Chaque extrant – output, composition ou publication - peut être d’autre part associé à un processus (notion à comprendre comme chaînes d’activités).
Les activités (i.e. actions mobilisées pour produire un extrant) sont organisées dans une structure ontologique – avec accès par une « roue d’activités » interactive. Chaque activité contribuant à un processus est représentée par une icône multidimensionnelle qui montre la catégorie de l’activité (couleur) et sa position dans la sous-hiérarchie de la catégorie (glyphe). Les activités sélectionnées sont ensuite structurées sous la forme de processus dans une grille de composition (outil visuel favorisant la formalisation et la description de flux d’activités) sous la forme d’un graphe soulignant les caractéristiques et les relations temporelles des activités particulières engagées dans le processus. Les processus gardent trace du cadre institutionnel dans lequel les travaux se sont déroulés (organisations, projets, personnel employé, etc.), des sources primaires utilisées en phase d’analyse, ou encore des techniques et outils utilisés pour produire les ressources numériques.
L’objectif général est de rendre compte d’épisodes successifs correspondant à des couples [lieu, temps]. Des chaînes d'évènements (que ceux-ci soient réels - observations in situ - ou fictifs, récits d’imagination) sont décrites sous la forme de quadruples [échelle spatiale, indicateur temporel, acteurs, indicateur de déplacement] et restituées sous la forme de visualisations en temps ordinal. Des paramètres quantitatifs et/ou qualitatifs peuvent être pris en compte, permettant d’associer à chaque épisode du parcours des indications causales ou contextuelles. L’approche a été testée d’une part sur les récits d’imagination (romans ou nouvelles), et d’autre part sur un parcours réel «origine destination ».
terrain d’expérimentation : récits d’imagination (romans ou nouvelles parcours réel «origine destination »)



Les dynamiques, les échelles temporelles d’observations ont été identifiées en tant que pistes de travail par le Conseil scientifique du PUCA. Celui-ci a souhaité qu’un état des lieux soit mené afin de faire le point sur les questions traitées, les problématiques. Cet état des lieux se traduit par une grille de lecture et un recueil de cas organisé, à fins de comparaisons, au travers de plusieurs niveaux de lecture. Chaque niveau de lecture correspond à un jeu de mesures exprimées d’une part sous la forme de commentaires, et d’autre part sous une forme normée devant permettre un travail systématique de comparaison puis de visualisation.
Ce petit « arsenal » de mesures sert donc à rendre possible une lecture de la collection dans son ensemble pour, par exemple, expliciter des choix implicites qui sont, potentiellement, des verrous méthodologiques persistants, à dépasser (on peut penser par exemple à la prédominance du paradigme « temps linéaire », ou à l‘absence de granularités temporelles alternatives).
L’ambition centrale du projet est d'expérimenter une démarche d'inventaire architectural "raisonné" tirant effectivement parti du développement des NTIC en matière de recueil, d’analyse et de visualisation d’informations.
Depuis le XIXe siècle, l’objet patrimonial est compris comme un témoignage matériel permettant de réfléchir sur l’histoire d’un lieu au sens large : l’inventaire doit ainsi éclairer l’architecture – art de bâtir-, mais aussi l’ensemble des circonstances qui la font naître et se transformer - matérialisation d’une rencontre entre des lieux, des périodes, et les sociétés qui successivement s’en emparent.
Le projet doit permettre de s'interroger au fil de l'eau sur comment continuer aujourd’hui un tel effort de long terme en tirant effectivement parti des avancées scientifiques et technologiques récentes.
terrain d’expérimentation: des chapelles isolées en Haute Provence
Expérimentation d'une méthode d'inventaire, d'analyse et de croisements de sources / de faits autour de l'ensemble des édifices situés ou s'étant situés dans et autour de la place centrale de Cracovie (une quarantaine d'édifices, une centaine de tranformations attestées, sur un millénaire environ).
acquisition de données (consultation et dépouillement d'archives, monographies, documents iconographiques, restitutions, sources cartographiques, sites Web),
analyse de contenus architecturaux de la collection,
étude, description et caractérisation des chaînes d’évènements (appliqués aux objets architecturaux) et de leurs dépendances, la contextualisation,
gestion de schémas d'alternatives (temps ramifié),
visualisation de la variabilité en précision et en crédibilité des données manipulées (incertitude),
terrain d’expérimentation : l’ensemble des bâtiments de la place centrale de Cracovie et une sélection de bâtiments médiévaux européens à usage public et commercial pour comparaison avec les premiers
Méthode permettant de ramener différents types d'objets 3D moulurés vers un formalisme d'analyse commun.
La réduction de l’objet 3D à un profil 2D (le profil est décrit comme une liste de segments -moulurés ou non- isolés par des points de contrôles correspondant à des inversions de courbes significatives) et sa restitution sous une forme graphique abstraite nous permet d’évaluer visuellement les traits fondamentaux d’un objet mouluré (rythmes, proportion, séquences, etc.) et de mettre en évidence des motifs récurrents, ou des éléments discordants au sein d’une collection, etc..
terrain d’expérimentation : différents objets, différents lieux, différentes époques
Étude des caractéristiques de différents calendriers historiques afin d’en faciliter une mise en comparaison synthétique. L'analyse de résultats visuels permet de souligner des rapports de proximité attendus ou inattendus dans la façon dont différentes sociétés ont domestiqué la notion de temps.
terrain d’expérimentation : différents calendriers, différentes civilisations, différentes périodes de l’histoire
L’objectif de l’étude est de mettre en évidence visuellement les modalités de diffusion et de variation, dans l’espace et dans le temps, du « type architectural » Chalaisien (ordre monastique couvrant le Dauphiné et la Haute-Provence).
champs d'expérimentation : architecture de l’ordre de Chalais (France)


Tactichronie est un dispositif à vocation ludo-pédagogique permettant à des voyants comme à des non-voyants de comprendre les transformations de l’espace bâti au cours du temps en manipulant un jeu de formes alternatives, différentiables au toucher.
Tactichronie permet de disposer dans une maquette-puzzle chronologique représentant un fragment de tissu urbain les évolutions successives de lieux architecturaux, repérées dans le temps et l’espace de façon univoque par des codes tactiles (i.e. tridimensionnels). La chronologie complète relative à chaque édifice est par ailleurs représentée sous la forme d’une frise chronologique tactile.
champs d'expérimentation : l’ensemble de la place centrale de Cracovie, basilique Notre-Dame de Cracovie
L’objectif de l’étude est une analyse comparative de la composition d’élévations occidentales et de la distribution en plan de cathédrales et basiliques gothiques construites entre 1100 et 1300 afin de repérer au travers de dispositifs de visualisation d’informations des similitudes, des divergences, ds filiations, règles ou d’exceptions (etc.)
champs d'expérimentation : cathédrales gothiques fondées entre le XIIe et le XIIIe siècle en France, Belgique, Allemagne
Faute de renseignements suffisants sur leur nature physique, des lieux architecturaux sont souvent connus essentiellement par un repère toponymique : nom(s) historique(s) du lieu quelle que soit l’échelle à laquelle on s’intéresse. Nous expérimentons ici un modèle générique de toponyme qui permet de localiser de façon univoque, dans une hiérarchie simulant la notion d’échelle et dans une chronologie, un jeu de données par rapport aux objets qu’il documente. Ces toponymes sont par ailleurs représentables sous la forme de représentations « chrono-cartographiques » qui permettent de visualiser en 2D leurs évolutions dans l’espace (localisation et/ou couverture spatiale).
champs d'expérimentation : jeux de toponymes test, toponymie historique ‘Pologne'


Le projet « Multi-exploitation du modèle numérique en architecture » a été l’occasion de tenter d'intégrer une logique de modélisation spatiale (du relevé à la maquette 3D), à une logique d’analyse documentaire (de la donnée brute – vieille photographie, dessin, à l’analyse croisée) au sein d'un dispositif d'interfaçage expérimental appelé infosphere.
Terrain d’expérimentation : Le Fort Saint Jean (Marseille)

Dans l’étude du patrimoine bâti, le développement des technologies de l'information a amélioré les conditions dans lesquelles sont organisés, représentés et distribués des jeux de données, d'informations ou de connaissances.
Mais la compréhension de l’édifice aux différentes échelles (corpus des objets, logique du tissu urbain, architecture urbaine, …), s’appuie non seulement sur une analyse du bâti mais aussi sur une analyse de ses évolutions, et sur la prise en compte des doutes que nous avons à ce sujet. Dans ce domaine d’application particulier, les informations sont qualifiées entre autre par une évaluation de leur crédibilité, interrogeant les formalismes informatiques existants et les modèles à mettre en œuvre. Le projet a permis développer dans un cadre applicatif concret une méthode d'analyse croisant représentation des connaissances et visualisation d'informations, méthode appelée modélisation informationnelle.
champs d'expérimentation : le centre historique de Cracovie / le village médiéval déserté de Rougiers

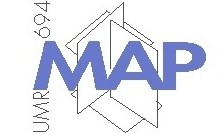

programme européen, initiative EUMEDIS
Workpackage 6 - Interfaces de navigation 2D/3D dans les contenus, travail dans lequel les maquettes 2D/3D sont conçues comme des outils de navigation dans un jeu de données hétérogènes et réparties.
champs d'expérimentation: sites antiques d’Arles (France) et de Dougga (Tunisie)/ jeu de 36 théâtres antiques, répartis dans quatre pays autour de la méditerranée /des éléments du corpus architectural général
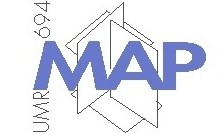
La maquette numérique utilisée comme moyen de simuler une hypothèse de restitution, pose à l'auteur de *l'hypothèse trois grandes familles de questions:
*la représentation à différentes échelles adéquate au niveau d'abstraction considéré;
*la gestion des niveaux de détails et la définition de codes de représentation pour figurer des niveaux de certitude;
l'incomplétude dans les hypothèses de restitution ou différentier l'original et le reconstruit/réemployé.
Dans cette plateforme nous combinons deux jeux d'informations, des instances (VIA, objets architecturaux) et des sources documentaires (SOL2). A partir de ce jeu d'informations nous avons d'abord proposé des scènes 2D/ 3D dont le langage graphique est une première réponse aux questions ci-dessus.
Par la suite, le système d'informations constitué a permis d'expérimenter un ensemble de modalités d'interfaçage graphique s'appuyant sur la forme architecturale:
*des scènes 3D interactives prédéfinies correspondant aux dates clés dans l’évolution de la ville,
*des scènes 2D/3D interactives pondues au vol en réponse à des requêtes utilisateur soit sur un(des) objets soit sur un(des)documents,
*un mécanisme de localisation spatiale approximative de sources visuelles,
un mécanisme de localisation spatiale du contenu "architectural" d'un document ou d'une collection,
*une visualisation (2D) objet par objet, et pour chaque évolution de l'objet, des densités de changements, ainsi que du type, du nombre et de la crédibilité des documents disponibles pour chaque objet.
Les jeux d'informations produits ainsi que les bases méthodologiques assemblées pendant ce projet ont nourri les expériences ultérieures menées sur le centre historique de Cracovie.
terrain d’expérimentation: le centre historique de Cracovie

Le projet vise à tirer profit du développement d’un ensemble de techniques informatiques (approche Objet, technologies du Web, représentation 3D, etc.) pour tenter de jeter les bases d'un système d'informations localisées spatialement à l'échelle architecturale, dans lequel la représentation de l'édifice servirait d'interface de navigation privilégiée.
C'est la nature même des sources documentaires considérées qui appelle une telle utilisation de la maquette numérique tridimensionnelle: des textes anciens aux relevés de fouilles en passant par l'iconographie des objets étudiés, la plupart des documents à référencer traitent au minimum d'un lieu dans la ville, et le plus souvent d'un lieu architectural (édifice, partie d'un édifice, ensemble d'édifice). Dés lors il est tentant de rapporter ces documents aux concepts dont ils relèvent; ceux de l'analyse du bâti, et donc d'utiliser une représentation de ces concepts pour accéder aux informations relatives à l'édifice patrimonial aux différentes échelles.
champs d'expérimentation: centre historique de Cracovie (Pologne), site antiques d’Arles (France) et de Dougga (Tunisie)


Cet outil, modeleur 3D interactif produisant du VRML, intervient comme un outil de visualisation rapide d'une hypothèse de restitution archéologique ou architecturale. Il intègre un mécanisme de codification des profils architecturaux et un jeu de "formes prototypiques".
terrains d’expérimentation : les Etalages Riches, les anciens plafonds en bois des maisons urbaines de Cracovie


SOL est un outil de recherche bibliographique, iconographique et cartographique sur le web dans lequel des critères de description issus d'une analyse de chaque entrée sont ajoutés aux critères descriptifs traditionnels. Chaque contribution au système (ajout d'une entrée au travers de l'interface de mise a jour sur le web) est le résultat d'une lecture critique de la ressource à indexer, mise à disposition de la communauté de chercheurs. SOL est donc un module d'information collaboratif que chaque participant peut enrichir, notamment dans le cadre de recherches doctorales.
champs d'expérimentation : l’ensemble de la place centrale de Cracovie


Le dictionnaire méthodologique pour le vocabulaire architectural DIVA est la partie émergée du travail d'identification, de nomminalisation et de structuration des concepts architecturaux qui sous-tend nombre de nos autres travaux.
Dans sa première implémentation, l'objectif du dictionnaire était de permettre une désignation commune et non équivoque d'éléments du corpus architectural, en trois langues.
L'outil a par la suite très largement évolué avec notamment l'intégration de relations entre concepts (sémantique inspirée de la linguistique: hyponymie, antonymie, méronymie, etc.), la recherche d'informations par l'image, l'ajout d'autres langues, des définitions multiples,etc.


L’ancien hôtel de ville de Cracovie, dont ne subsiste aujourd'hui que le beffroi, a été étudié avec pour objectif d'en restituer les évolutions architecturales depuis sa fondation (XIVe siècle).
De nombreuses études architecturales ou archéologiques publiées depuis deux siècles servent de références à un travail de restitution marqué par trois exigences:
- distinguer visuellement le connu de l'hypothètique, y compris dans des représentations à caractère réaliste,
- autoriser l'évaluation visuelle d'hypothèses contradictoires,
- organiser le contenu des maquettes (objets géométriques) en fonction d'une décomposition architecturale de l'édifice.

L’interface Hublot permet de créer et de visualiser un ensemble d’arrangements spatiaux utilisant le modèle architectural prédéfini, par exemple une hypothèse de restitution (un jeu d'entités architecturales et de relations les liant les unes aux autres).
terrains d’expérimentation : les Étalagés Riches, les anciens plafonds en bois des maisons urbaines de Cracovie

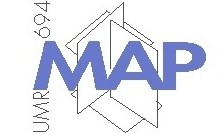
Dans le domaine de l'architecture et de ses rapports avec le territoire et la ville, différents organismes et établissements français et européens se sont associés pour créer le réseau @archi.fr.
Dans ce cadre le laboratoire MAP a développé un ensemble d'outils d’aide à la recherche d’informations et a assuré le rôle de tête de réseau pour la communauté ainsi réunie - écoles d’architecture et organismes publics de promotion de l’architecture. Notre intervention dans ce projet a été avant tout d'ordre technique et organisationnelle.


1998-2000 PAI POLONIUM - Programme d'Actions Intègres MAE /CNRS/KBN), 2001-2003 PICS (Programme International de Coopération Scientifique CNRS/KBN)
ARKIW est un programme de coopération et d'échanges scientifiques entre le laboratoire MAP-GAMSAU UMR CNRS 694 et l'institut HAiKZ de la Faculté d'Architecture de Cracovie (Pologne), programme dont le thème central est la définition de méthodes et d'outils de formalisation des connaissances et de gestion de données en réseau au service de l'étude de l'architecture urbaine.
terrains d’expérimentation: le centre historique de Cracovie, l’ensemble de la place centrale de Cracovie, l’ancien Hôtel de Ville, les Étalages Riches, les anciens plafonds en bois des maisons urbaines de Cracovie.